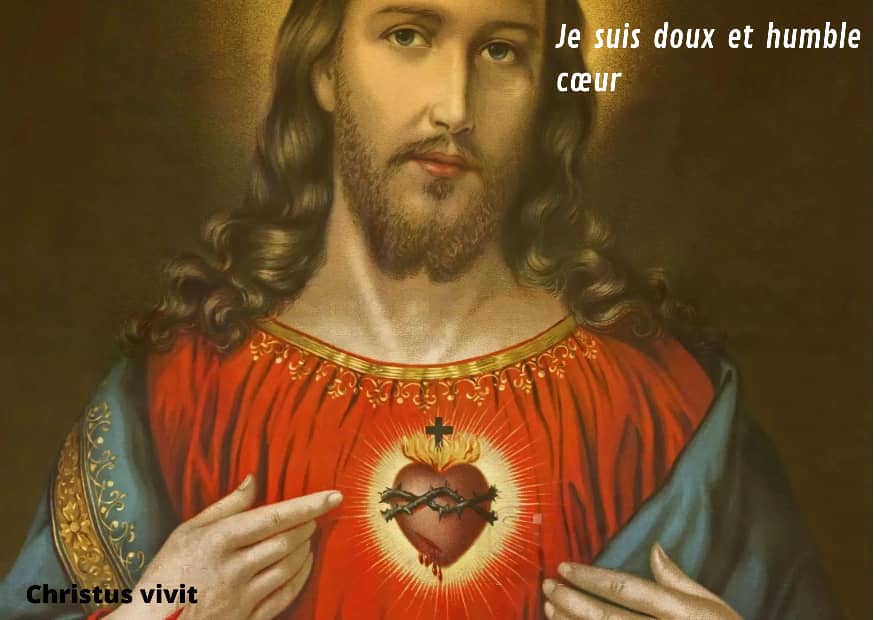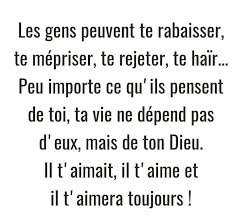Dans l’humilité, mon soutien, la création s’épanouit sur l’ordre de Dieu. En cette humilité, Dieu se penche vers moi pour donner à nouveau le bonheur aux feuilles mortes – les hommes – qui sont tombées, un bonheur qui inspire toutes ses volontés : il les avait pétries avec la terre, et, après leur chute, il les relève.
Dieu a réalisé toutes ses œuvres dans l’amour, l’humilité et la paix, afin que l’homme appréciât l’humilité et saisît également la paix pour ne pas sombrer avec celui qui, dès le début, tourne ces vertus en dérision. Ces vertus ne sont pas plus séparées de la divinité que la racine de l’arbre : Dieu, qui est amour, conserve son humilité en toutes ses œuvres et dans tous ses jugements. Amour et humilité descendirent sur terre avec le Fils de Dieu, et c’est encore eux qui l’accompagnèrent, quand il rejoignit le ciel. L’amour brûle dans l’ardeur des cieux comme la pourpre, et l’humilité, dans la candeur de la droiture, écarte toute souillure de la terre.
L’amour est l’ornement des œuvres de Dieu, telle la pierre précieuse sertie sur une bague. L’humilité s’est manifestée et révélée dans l’humanité du Fils de Dieu, elle a jailli de la pure Étoile de la Mer, Marie. (…) L’humilité ne détient rien, elle maintient tout au sein de l’amour. C’est en son sein que Dieu se penche vers la terre, et c’est par l’humilité qu’il rassemble les vertus.