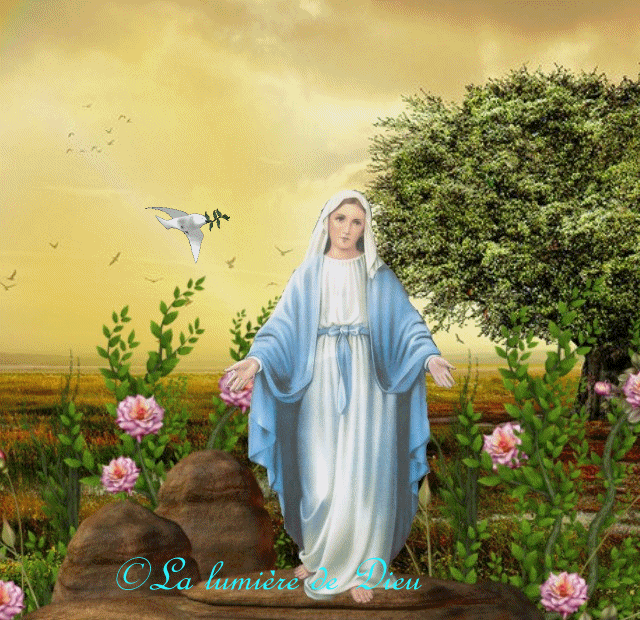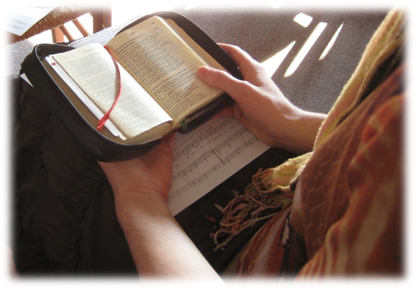C’est l’unique et même Christ qui est présent dans le pain eucharistique en tout lieu de la terre. Cela signifie que nous ne pouvons le rencontrer qu’avec tous les autres. Nous ne pouvons le recevoir que dans l’unité. N’est-ce pas ce que nous a dit l’apôtre Paul ? Écrivant aux Corinthiens, il affirme : « Puisqu’il y a un seul pain, à plusieurs nous sommes un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1Co 10,17). La conséquence est claire : nous ne pouvons pas communier avec le Seigneur, si nous ne communions pas entre nous. Si nous voulons nous présenter à lui, nous devons également nous mettre en mouvement pour aller à la rencontre les uns des autres. C’est pourquoi il faut apprendre la grande leçon du pardon : ne pas laisser notre âme être rongée par le ressentiment, mais ouvrir notre cœur à la magnanimité de l’écoute de l’autre, ouvrir notre cœur à la compréhension à son égard, à l’éventuelle acceptation de ses excuses, au don généreux des nôtres.
L’eucharistie, répétons-le, est le sacrement de l’unité. Mais malheureusement, les chrétiens sont divisés, précisément dans le sacrement de l’unité. Soutenus par l’eucharistie, nous devons d’autant plus nous sentir incités à tendre de toutes nos forces à cette pleine unité que le Christ a ardemment souhaitée au Cénacle (Jn 17,21-22). (…) Je voudrais réaffirmer ma volonté de prendre l’engagement fondamental d’œuvrer avec toute mon énergie à la reconstruction de l’unité pleine et visible de tous les disciples du Christ. Je suis conscient que les manifestations de bons sentiments ne suffisent pas pour cela. Il faut des gestes concrets qui entrent dans les âmes et qui secouent les consciences, sollicitant chacun à cette conversion intérieure qui est le présupposé de tout progrès sur la route de l’œcuménisme.
 Au lendemain de la solennité de Noël, nous célébrons aujourd’hui la fête de saint Étienne, diacre et premier martyr. À première vue, le rapprochement…avec la naissance du Rédempteur peut nous surprendre, car on est frappé par le contraste entre la paix et la joie de Bethléem et le drame d’Étienne… En réalité, le désaccord apparent est dépassé si nous considérons plus en profondeur le mystère de Noël. L’enfant Jésus, couché dans la grotte, est le Fils unique de Dieu qui s’est fait homme. Il sauvera l’humanité en mourant sur la croix. À présent, nous le voyons enveloppé de langes dans la crèche ; après sa crucifixion, il sera à nouveau enveloppé de bandes et déposé dans un sépulcre. Ce n’est pas un hasard si l’iconographie de Noël représentait parfois le divin Nouveau-né couché dans un petit sarcophage, pour indiquer que le Rédempteur naît pour mourir, naît pour donner la vie en rançon pour tous (Mc 10,45).
Au lendemain de la solennité de Noël, nous célébrons aujourd’hui la fête de saint Étienne, diacre et premier martyr. À première vue, le rapprochement…avec la naissance du Rédempteur peut nous surprendre, car on est frappé par le contraste entre la paix et la joie de Bethléem et le drame d’Étienne… En réalité, le désaccord apparent est dépassé si nous considérons plus en profondeur le mystère de Noël. L’enfant Jésus, couché dans la grotte, est le Fils unique de Dieu qui s’est fait homme. Il sauvera l’humanité en mourant sur la croix. À présent, nous le voyons enveloppé de langes dans la crèche ; après sa crucifixion, il sera à nouveau enveloppé de bandes et déposé dans un sépulcre. Ce n’est pas un hasard si l’iconographie de Noël représentait parfois le divin Nouveau-né couché dans un petit sarcophage, pour indiquer que le Rédempteur naît pour mourir, naît pour donner la vie en rançon pour tous (Mc 10,45).