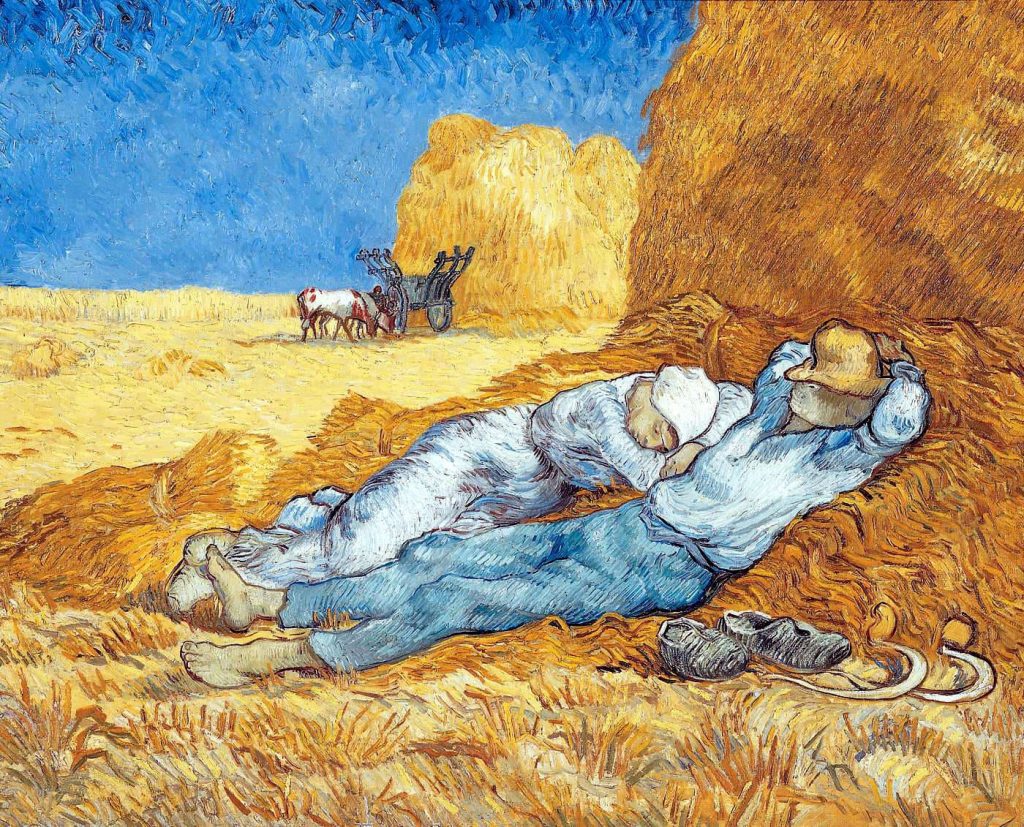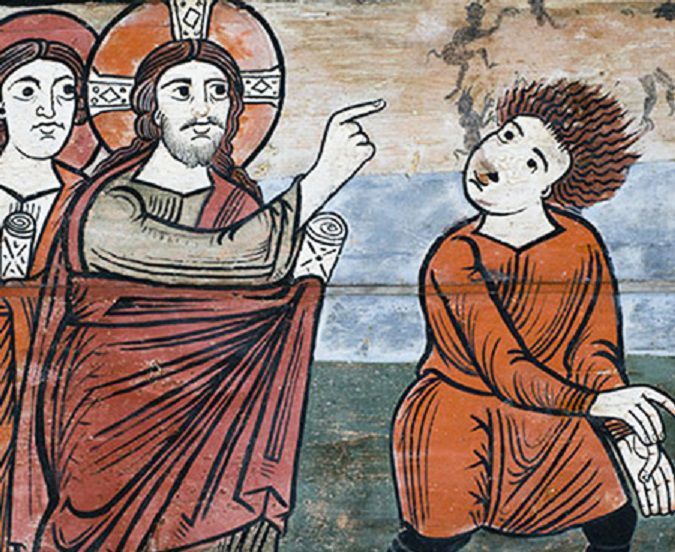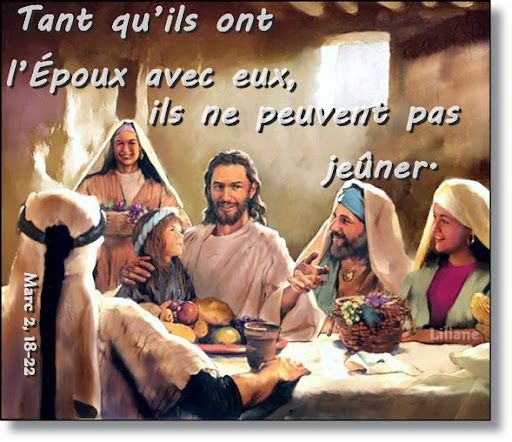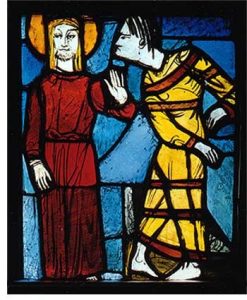Si l’eucharistie est le mémorial de la Pâque du Seigneur, si par notre communion à l’autel nous sommes « comblés de toute bénédiction céleste et grâce » (Canon romain), l’eucharistie est aussi l’anticipation de la gloire céleste. Lors de la dernière Cène, le Seigneur a lui-même tourné le regard de ses disciples vers l’accomplissement de la Pâque dans le Royaume de Dieu : « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le Royaume de mon Père » (Mt 26,29). Chaque fois que l’Eglise célèbre l’eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers « Celui qui vient » (Ap 1,4). Dans sa prière, elle appelle sa venue : « Marana tha » (1Co 16,22), « Viens, Seigneur Jésus » (Ap 22,20). « Que ta grâce vienne et que ce monde passe ! » (Didaché)
L’Eglise sait que, dès maintenant, le Seigneur vient dans son eucharistie et qu’il est là au milieu de nous ; cependant, cette présence est voilée. C’est pour cela que nous célébrons l’eucharistie en « attendant la bienheureuse espérance et l’avènement de notre Sauveur Jésus Christ » (Tt 2,13), en demandant « d’être comblés de ta gloire, dans ton Royaume, tous ensemble et pour l’éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux ; en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ, notre Seigneur » (Prière eucharistique 3).
De cette grande espérance, celle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle en lesquels habitera la justice (2P 3,13), nous n’avons pas de gage plus sûr, de signe plus manifeste que l’eucharistie. En effet, chaque fois qu’est célébré ce mystère, « l’œuvre de notre rédemption s’opère » (LG 3) et nous « rompons un même pain qui est remède d’immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus Christ pour toujours » (St Ignace d’Antioche).