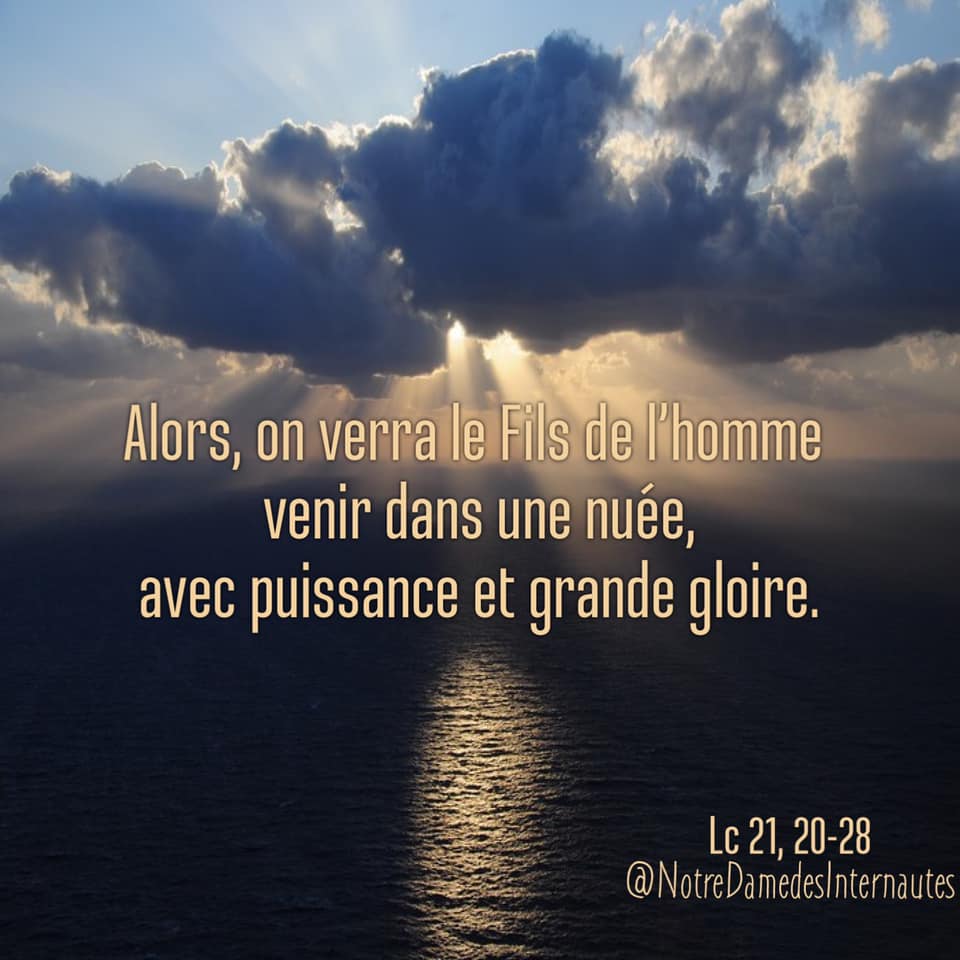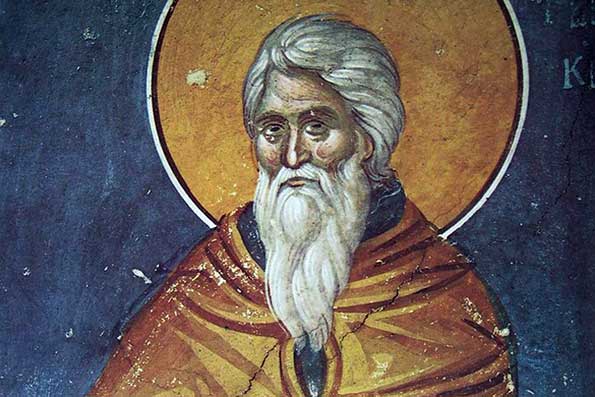« L’oreille ne sait-elle pas juger des paroles et le palais de la saveur des mets ? » (Jb 12,11 Vg) Il n’échappe sans doute à personne que les cinq sens de notre corps, la vue l’ouïe, le goût, l’odorat et le toucher, en tout ce qu’ils sentent et distinguent tirent du cerveau leur pouvoir de distinguer et de sentir. Et si le sens du cerveau est le juge unique qui préside en nous, c’est cependant grâce aux organes qui leur sont propres qu’il distingue les cinq sens, Dieu opérant cette merveille : l’œil n’entend pas, l’oreille ne voit pas, la bouche ne sent pas, les narines ne goûtent pas et les mains n’ont pas d’odorat. Enfin, si l’ordonnance de ces activité relève uniquement du sens du cerveau, il reste que chacun des sens ne peut exercer que l’activité qu’il a reçue par l’ordonnance même de l’architecte souverain.
De ces considérations physiologiques et extérieures il faut donc tirer des conclusions intérieures et spirituelles : nous devons dépasser ce qui en nous se manifeste au monde pour aller à ce qui en nous est secret et nous échappe à nous-mêmes. Il faut, en effet, observer que si la sagesse est une par elle-même, elle réside dans les individus à des degrés divers ; elle accorde tel pouvoir à l’un, tel autre à l’autre, et, à la manière du cerveau, elle fait de nos personnes en quelque sorte des sens spécialisés, si bien que, sans jamais être dissemblable à elle-même, par notre entremise cependant elle agit, en des sens variés et des œuvres dissemblables, l’un recevant le don de sagesse, l’autre de science, l’un possédant les diversités des langues, l’autre le charisme des guérisons.